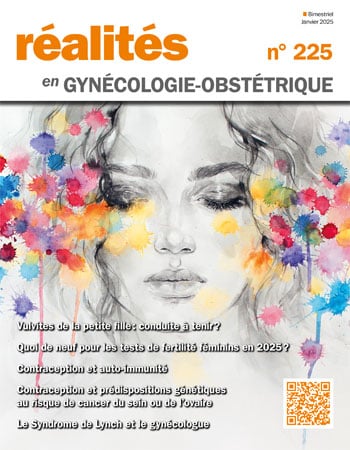- La deuxième génération
- 1. Les filles de la génération 2
- 2. Les garçons de la génération 2
- La troisième génération
- 1. Le contexte d’infertilité maternelle
- 2. Les complications de la prématurité : paralysie cérébrale
- 3. Effets transgénérationnels du DES : malformations congénitales
- 4. Effets transgénérationnels du DES : les cancers
- Conclusion
L’histoire de l’exposition au diéthylstilbestrol, communément appelé DES, est celle d’un espoir gigantesque proposé aux femmes en réponse au malheur qu’ont de tout temps représenté les fausses couches, avant d’être celle d’une tout aussi gigantesque erreur médicale, de l’inertie des pouvoirs publics face à l’alerte des premières complications décrites et de la prise de conscience tardive des effets indésirables par le corps médical.
DES est la dénomination commune internationale du diéthylstilbestrol, découvert en 1938 par le chimiste anglais Charles Dodds, développé pour ses propriétés d’imitation de l’action des estrogènes naturels, commercialisé sous les noms de spécialités Distilbène et Stilboestrol-Borne [1]. Il fut prescrit chez les femmes enceintes aux États-Unis, puis dans divers pays, dont la France entre 1948 et 1977, notamment pour les menaces d’avortements spontanés et les hémorragies gravidiques, mais bien souvent aussi de façon préventive dans de multiples situations sans indication avérée. Le DES est alors considéré comme une “pilule miracle” (fig. 1).
Le travail de Dieckmann, mené à Chicago, paru en 1953, étude randomisée en double aveugle remarquable pour l’époque, comparait le suivi de 840 femmes enceintes traitées par DES et 806 traitées par placebo, en concluant à une absence de différence significative entre les deux groupes concernant les avortements spontanés, la prééclampsie, la prématurité, la post-maturité ou la mortalité périnatale [2]. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Néanmoins, ces conclusions n’ont pas influé sur les habitudes thérapeutiques. En France, les prescriptions débutées en 1948 progressent pour atteindre un pic en 1971. C’est aussi l’année[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire